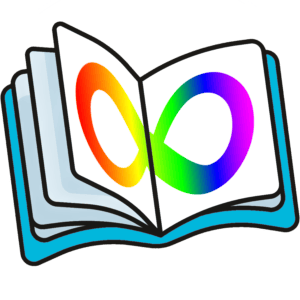L’Université du Luxembourg dispose d’un Bureau de l’inclusion et d’une Commission des aménagements raisonnables. Ils veulent « promouvoir une culture de l’inclusion dans l’ensemble de l’université ». Pour atteindre cet objectif, ils proposent des conseils et un soutien. Ils veulent offrir aux étudiant·es une « expérience d’apprentissage positive, indépendante et efficace » et « maximiser leur capacité à étudier ».
Vous trouverez plus d’informations à propos du Bureau de l’inclusion et de la Comission des aménagements raisonnables sur : www.uni.lu > Vie sur campus > Inclusion et bien-être > Accompagnement des personnes en situation de handicap
Public cible
- Étudiant·s avec divers handicaps et ayant des besoins physiques et sensoriels, des difficultés d’apprentissage ou des maladies médicales
- Personnel
- Visiteurs
Le bureau de l’inclusion est chargé de
- Organiser des formations, des ateliers et des séminaires liés à l’inclusion et à la diversité.
- Fournir des ressources et un soutien aux groupes sous-représentés.
- Bâtir une communauté en favorisant un sentiment d’appartenance et de communauté pour tous les étudiant·es.
- Travailler en étroite collaboration avec les départements universitaires et les associations étudiantes pour intégrer les principes d’inclusion dans la vie universitaire.
- Résoudre les problèmes liés à l’intimidation, au harcèlement, à la discrimination et aux abus sexuels.
- Proposer des services d’accessibilité.
- Proposer des services de mentorat, des conseils et un soutien aux étudiant·es.
uni.lu/life-fr/inclusion-bien-etre/contact/
Spécialistes d’inclusion du Bureau de l’inclusion
Les personnes suivantes font partie du Bureau de l’inclusion :
- Centre LGBTIQ+ Cigale,
- Joanna West (chef d’équipe Services aux étudiants),
- Vinicius Jobim Fischer (psychologue),
- Claire Lallier (psychologue et psychothérapeute),
- Aakriti Varshney (psychologue),
- Jimmy Corneille (spécialiste de l’inclusion et du bien-être),
- Caroline Deylaud-Koukabi (spécialiste de l’inclusion et du bien-être),
- Irmgard Schroeder (psychologue diplômée),
- Marcela Zambrano (psychologue / Inclusion).
Afin de pouvoir les contacter, vous devez créer un compte Kara connect.
Autisme & réussite universitaire
Andreia Costa est une chercheuse dévouée spécialisée dans l’autisme. Dans cette interview vidéo du Bureau d’inclusion de l’Université, elle parle des stratégies et des systèmes de soutien qui aident les étudiants autistes à s’épanouir dans un environnement universitaire.
Transcription en français
Interviewer : (0:07) Pouvez-vous expliquer quels défis rencontre un étudiant autiste à l’université ? (0:13) Pour expliquer, qu’est-ce que l’autisme ?
Andreia Costa : (0:16) Les difficultés qu’ils rencontrent très souvent dans le cadre académique sont la socialisation, (0:21) les contacts, les difficultés à interagir avec leurs pairs, les difficultés à communiquer avec les professeurs, (0:26) aussi l’adaptation à un nouveau cadre qu’est l’université, donc un cadre moins structuré (0:33) que celui qu’ils avaient auparavant au lycée, ayant de nouvelles exigences sur ce qui est attendu (0:39) d’eux, devant défendre leurs propres intérêts et devant aussi faire face à plus d’imprévisibilité.
Interviewer : (0:47) Si nous pensons à ces défis, quels aménagements raisonnables pourraient être mis en place ?
Andreia Costa : (0:55) Pour aider les étudiants autistes à faire face à ces difficultés, nous pouvons très souvent recommander des choses comme fournir aux étudiants le matériel de cours à l’avance, donc les professeurs fournissant les PowerPoints ou les PDF des documents dont ils ont besoin à l’avance, leur donner des instructions claires sur les devoirs qu’ils auront. (1:19) Une difficulté qui survient très souvent concerne l’évaluation. (1:23) Donc, en termes d’évaluation, nous pouvons par exemple, dans un cours où les étudiants doivent faire des présentations orales, faire ces présentations via un enregistrement vidéo au lieu de le faire devant la classe. (1:38) Pour les travaux de groupe, les étudiants peuvent peut-être aussi ajuster un peu la dynamique du groupe. (1:46) Une autre possibilité serait de faire un examen oral par visioconférence au lieu de le faire en face à face, pour les examens avoir peut-être plus de temps ou aussi pouvoir faire l’examen dans une salle différente.
Interviewer : (2:04) J’ai donc compris qu’un défi pourrait être l’interaction sociale d’une personne autiste avec ses camarades de classe. (2:12) Y a-t-il des mesures qu’un enseignant peut prendre pour aider et faciliter ces interactions entre pairs, qui sont une partie importante des études ?
Andreia Costa : (2:22) Un système de parrainage, où l’étudiant peut avoir quelqu’un de la classe qui l’aide dans son interaction avec le professeur, est généralement un système qui fonctionne bien. (2:32) Cela peut être quelqu’un de la classe, mais aussi vraiment quelqu’un qui est désigné par l’université, qui peut aider l’étudiant à communiquer ses besoins au professeur et aussi à communiquer avec les autres étudiants sur ce dont ils ont besoin et quelles sont parfois leurs difficultés.
Interviewer : (2:50) Merci beaucoup !
Andreia Costa : (2:52) Merci !
Commission pour les aménagements raisonnables (CAR)
En juillet 2018, il y avait une nouvelle loi. Joanna West a été nommée présidente de la commission pour les aménagements raisonnables. En tant que présidente de la CAR, elle est également membre du Conseil de l’université, à titre consultatif.
L’objectif de la commission est de travailler ensemble pour s’assurer que les aménagements nécessaires et appropriés sont faits pour soutenir les étudiant·es ayant des besoins spéciaux dans le cadre de leurs études et de leur bien-être personnel.
Composition de la commission
- un membre du rectorat,
- un·e directeur·trice de programme d’études par faculté,
- le·la délégué·e aux aménagements raisonnables
- et deux membres des représentant·es des étudiant·es nommé·es par le Conseil de l’Université.
Aménagements raisonnables
Quand un·e étudiant·e veut des aménagements, il·elle doit écrire un e-mail à contact.car@uni.lu. L’ensemble du processus d’ouverture des dossiers, de discussion et de prise de décision doit être achevé dans un délai de 30 jours. Il y a des délais à respecter :
Pour le semestre d’hiver, les étudiant·es doivent déposer leur demande avant le 15 octobre. Pour le semestre d’été, les étudiant·es doivent déposer leur demande avant le 15 mars.
Le Comité pour les ajustements raisonnables (CAR) décide si l’étudiant·e est autorisé·e à bénéficier d’ajustements raisonnables. L’université demande
pour les rapports médicaux, psychologiques ou de diagnostic, rédigés par un médecin ou un· autre professionnel·le dûment qualifié·e dans ce domaine.
13 aménagements différents peuvent être mis en place :
- évaluations alternatives,
- changement de salle,
- salle séparée pour les évaluations,
- présentation adaptée des épreuves d’évaluation,
- temps supplémentaire,
- pauses supplémentaires,
- utilisation d’un support technologique et/ou d’un assistant,
- fractionnement des évaluations,
- dispense,
- prise en charge des évaluations ou de certains éléments d’un programme d’études en dehors de l’université.
Vous trouverez plus de détails dans une brochure PDF en suivant le lien ci-dessus.
Service de santé mentale et de bien-être
Le service de santé mentale et de bien-être aide les étudiant·es et le personnel à faire face à des difficultés telles que
troubles de l’humeur, troubles de l’alimentation, dépendance, deuil, estime de soi et difficultés relationnelles, [difficultés d’étude ou de travail]. L’équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Questions
- Quels sont des aménagements fréquemment demandés par des étudiant·es autistes ?
- Quelle expérience les spécialistes de l’inclusion du Bureau de l’inclusion, de la Commission des aménagements raisonnables et du Service de santé mentale et de bien-être ont-ils des étudiant·es autistes ?
- Comment les étudiant·es procèdent-ils·elles lorsqu’ils·elles veulent entrer en contact avec d’autres étudiant·es ?
- Que peuvent faire les étudiant·es si leur demande n’est pas acceptée ?
- Y a-t-il un retour de la part d’étudiant·es ?